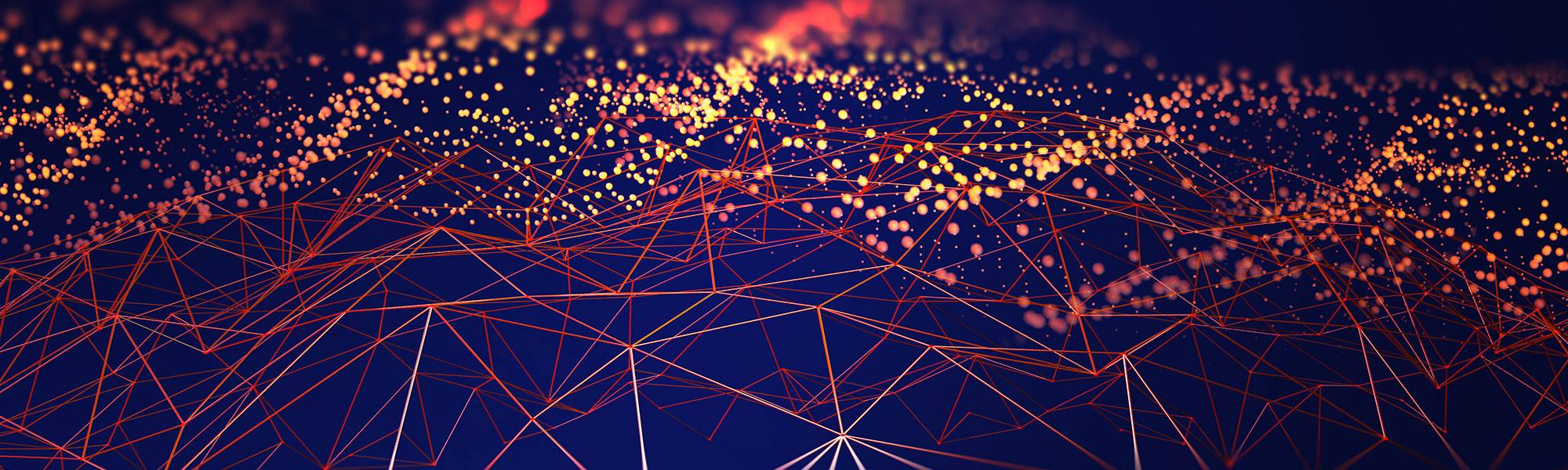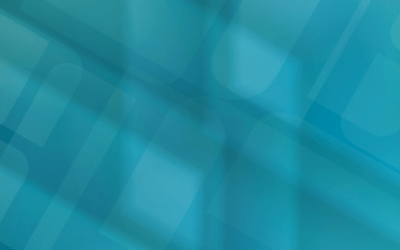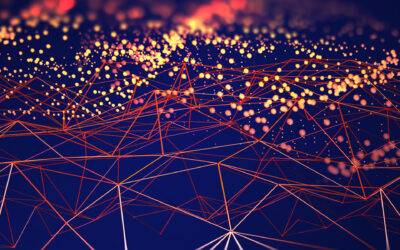Une représentation déséquilibrée des femmes dans le domaine de l’IA
Une sous-représentation persistante des femmes dans les STEM et l’IA
Une défiance nourrie par des préoccupations éthiques, de transparence et de gouvernance
Biais de genre dans les algorithmes : un miroir amplifiant les inégalités
Santé, IA et genre : pour une médecine réellement inclusive
- Un algorithme de deep learning analysant des mammographies a permis de détecter précocement des risques de cancer du sein.
- L’IA améliore la prédiction des complications post-partum ou les parcours de soins adaptés à la santé reproductive.
- Des plateformes numériques facilitent un meilleur accès à l’information médicale et un suivi personnalisé pour les femmes.
IA et assurance : entre risques discriminatoires et leviers d’équité
- L’adoption d’approches d’évaluation globale des risques, intégrant des facteurs comportementaux au lieu de se concentrer uniquement sur des pathologies féminines.
- La transparence sur les critères utilisés pour fixer les primes en assurance, avec des audits d’algorithmes pour détecter d’éventuelles discriminations indirectes. Certains assureurs, notamment en assurance emprunteur, testent des solutions de scoring plus lisibles, où les critères d’acceptation sont expliqués plus clairement (ex. : stabilité de l’emploi, absence d’antécédents lourds, mode de vie sain), limitant ainsi l’opacité des décisions automatisées et favorisant l’équité.
- La mesure et l’atténuation des biais via des techniques d’IA dites “fairness-aware”, qui intègrent des contraintes d’équité, comme la Fairness-aware PCA appliquée à la tarification de l’assurance vie et à la prévision de mortalité (étude arXiv) permettant de corriger certains effets de proxy discrimination.
L’IA comme moyen de prévention
- Individualiser les messages de prévention en fonction des données de santé ou de mode de vie (âge, alimentation, activité physique, sommeil, antécédents familiaux)
- Proposer des programmes d’accompagnement numérique ou de coaching santé (applications mobiles, plateformes de conseils, suivi en ligne)
- Favoriser le dépistage précoce de certaines pathologies sous-diagnostiquées chez les femmes (maladies cardiovasculaires, troubles hormonaux, certains cancers)
De plus, des mémoires en actuariat montrent que la régulation algorithmique est possible, à condition d’y intégrer des métriques d’équité, des seuils d’acceptabilité et des indicateurs de transparence exploitables. En France, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a publié plusieurs recommandations pour encadrer l’usage de l’IA dans l’assurance. Son rapport de 2022 insiste sur :
- Un encadrement rigoureux des modèles (documentation, audits, traçabilité)
- Des contrôles de biais (éviter la proxy-discrimination)
- Une vigilance sur les usages en santé
- La désignation d’un responsable IA
Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre du règlement européen IA Act, qui encadre les systèmes à haut risque (assurance, santé, crédit) et du futur FIDA (Framework for Integrated Data Analysis), visant à encadrer l’usage des données dans l’UE. Elles rappellent l’importance d’un pilotage humain des décisions algorithmiques, afin d’éviter que les biais techniques ne se traduisent en injustices concrètes pour les assurées.
Travail et IA : des effets différenciés selon le genre
- Les politiques de formation sont inclusives et ciblées.
- Les femmes sont accompagnées pour accéder aux métiers de la data, du développement ou de l’éthique algorithmique.
- Les outils numériques favorisent la conciliation des temps de vie ou la flexibilité choisie.
Vers une IA plus égalitaire : initiatives, gouvernance et régulation
- Une meilleure représentation des femmes dans les carrières scientifiques, dès l’éducation secondaire (modèle féminin, valorisation historique, mentorat…) et la parité dans les postes stratégiques au sein des entreprises technologiques.
- Une analyse de genre tout au long du cycle de vie des technologies d’IA : collecte de données, développement, tests, déploiement.
- Des outils de détection et de correction des biais dans les modèles d’IA.
- Des chartes éthiques intégrant des principes d’égalité.
- Une gouvernance inclusive des écosystèmes d’IA, avec une représentation paritaire dans les comités de décision.
Des initiatives comme Women4Ethical AI et le Pacte pour une IA égalitaire témoignent de cette mobilisation croissante. Le règlement IA Act (2024) et le règlement FIDA en construction fournissent désormais un cadre juridique structurant. Ensemble, ces textes constituent un levier important pour construire une IA respectueuse des droits fondamentaux et sensibles aux enjeux de genre.
Conclusion
Découvrez nos autres contenus sur cette thématique :
Automatisation des données et des processus dans les fonctions actuarielles, financières et de gestion des risques
Automatisation des données et des processus dans l’assurance pour les fonctions actuarielles, de gestion des risques et financières : impacts, avantages, défis, facteurs de réussite… Découvrez pourquoi transformer vos processus
L’avenir de l’assurance : le pouvoir transformateur de l’IA dans l’explicabilité des résultats
Le secteur de l’assurance entre dans une nouvelle ère. Face aux exigences croissantes des assurés, à la complexité croissante des risques et à la pression sur les marges, les acteurs du marché doivent réinventer leurs modèles. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle s’impose comme un levier clé d’innovation et de performance.
AI Insights | IA Générative et assurance : Quels modèles pour quels usages ?
Des technologies innovantes telles que les grands modèles de langage, les réseaux antagonistes génératifs (GANs) et les modèles de diffusion s’imposent comme des leviers majeurs de cette transformation. Découvrez notre article.